Violences inexplicables ou colère légitime: l'insurrection comme avalanche
- Ella
- 5 juil. 2023
- 9 min de lecture
Dernière mise à jour : 12 juil. 2023
Il y a dix jours, Nahel Merzouk, adolescent Franco-algérien de dix-sept ans, était tué par un policier. Alors que l’événement aurait du être l’occasion d’un séisme gouvernemental, occuper tous les plateaux télés et être analysé sous toutes les plumes, circuler dans toutes les discussions amicales et familiales, l’agitation politique et médiatique actuelle laisse plutôt à croire que quelque chose d’encore plus grave, de clairement plus urgent, s’est déroulé depuis.
L’insurrection transformée en urgence politique
On assiste en effet en ce moment à la capacité du monde politico-médiatique à se saisir d’une situation et à en faire un problème politique de première nécessité et d’impérieuse gravité. Si seulement le volume horaire, le temps de parole et de réflexion, les moyens journalistiques et les mesures politiques, consacrées aux « émeutes », étaient plutôt dédiées à réparer et à écouter les victimes, à réformer de fond en comble la police, à juger les milices d’extrême droite qui œuvrent impunément aux côtés des forces de l’ordre.
Au lieu de ça, dans tous les bords politiques, on dénonce la violence de l’insurrection. Retour sur l’instrumentalisation et l’usage abusif d’une notion fondamentale.
La métaphore de l’avalanche: l’insurrection comme réaction
Une évidence, d’abord: l’insurrection actuelle est une réaction. Rien de tel ne se produirait si, en France, la police traitait correctement les personnes racisées*. Plus profondément, la colère des quartiers populaires ne serait pas telle sans l’enclavement géographique, le mépris médiatique et l’abandon politique qui condamnent lesdites populations à la précarité et à l’exclusion économiques dans l’indifférence générale. Les véritables et premiers responsables de l’insurrection actuelle sont ceux qui promulguent et ceux qui font respecter un ordre arbitraire, fondé sur la reproduction des privilèges et la silenciation des opprimé•es.
En logique, on distingue deux types de cause : la cause de proximité et la cause première** (ce sont mes mots, car je me suis toujours débrouillée pour éviter les cours de logique). Imaginons une avalanche dans une station de ski (pardonnez mon exemple bourgeois) : ce qui obstrue la piste est la chute de la neige - mais cette chute est elle-même premièrement causée par un coup de canon de déclenchement. Elle ne se serait pas produite si personne n’avait initialement décidé de déclencher des détonations, et encore moins si de tels canons n’avaient pas été sciemment installés dans la montagne.
La neige amassée sur les pistes, qui empêche que les vacancier•es skient comme si de rien n’était, c’est les voitures cramées, les manifestations, les larmes, l’ensemble des insurrections qui fleurissent en France ces derniers jours. L’avalanche qui a fait dégringoler la neige, c’est la colère. La détonation qui a généré l’avalanche, c’est le flic qui tire sur un môme. L’existence et la disponibilité même des canons qui déclenchent des avalanches, c’est l’ensemble de lois, de représentations et d’événements passés qui rendent possible (voire qui encouragent) qu’un policier tire sur un jeune racisé qui refuse d’obtempérer à Nanterre.
L’avalanche (la colère) alors, est effectivement ce qui explique et cause dans une certaine mesure la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve la piste (les insurrections et le trouble qu’elles peuvent causer). Mais est-elle la cause première, dans le double sens de principale, et d’antérieure aux autres causes ? L’avalanche est-elle située au début de la chaîne causale qui aboutit à l’obstruction des pistes ? Non. Ce qui cause réellement l’impraticabilité des pistes, c’est l’installation de canons d’une part, et leur usage arbitraire, abusif et illégitime d’autre part. Qu’est-ce que ça signifie ? Que questionner la légitimité des moyens insurrectionnels devrait toujours aller de paire avec une réflexion antérieure et plus profonde sur ce qui, structurellement, mène à une telle insurrection.
Le qualificatif de « violence », carton rouge disqualifiant toute dissidence
Or, depuis dix jours, qu’est-ce qui est décliné en reportages de terrains, conférences de presse, convocations de politologues, appels à rassemblements et communiqués syndicaux ? Ce n’est ni l’expérience vécue du racisme systémique, ni la réalité des violences policières, ni l’abandon politique et économique des quartiers populaires, sujets réellement et sérieusement investis par une poignée de médias indépendants et par certain•es député•es, accusé•es de cautionner l’insurrection parce qu’iels l’expliquent au lieu de la condamner.
Deux jours à peine après l’événement révoltant, infusaient déjà dans les discours politiques, les cadrages médiatiques et les discussions de comptoir, des dénonciations d’un autre ordre : tout est déployé pour mettre fin à la « violence », à la « nuisance », au « terrorisme », non pas de l’État policier, mais des réactions populaires survenues dans les quartiers. Les causes premières et principales de l’insurrection - les injustices qui ont mené les gens à se révolter - sont ignorées au profit d’un acharnement sur leurs causes de proximité - autrement dit sur les personnes qui prennent part à l’insurrection.
De plus, quand bien même le gouvernement et les intervenant•es médiatiques chercheraient et arriveraient à tenir ensemble une critique profonde et radicale des violences policières et de leur spécificité raciste, et une critique de la manière dont les jeunes y répondent aujourd’hui, encore faudrait-il s’accorder sur la définition de la violence. À l’heure actuelle, celle-ci est brandie comme un carton rouge visant à disqualifier la moindre forme d’expression populaire disruptive. En effet, tout, dans la bouche de trop de monde, est taxé de violence : les vols dans les supermarchés et les infractions dans les centres commerciaux, les destructions de vitres et de voitures, les tags de mairies et les « acab » tweetés ou clamés en manifestation. D’un autre côté, suivant un double standard pour le moins hypocrite, il n’y a pas grand monde, aux heures de grande écoute ou dans les rangs macronistes, pour dénoncer au quotidien la violence des contrôles au faciès, des tirs de flashball, des interpellations arbitraires et des humiliations en commissariat.
De quel côté la violence se situe-t-elle réellement ?
Qu’est-que la violence ? L’atteinte profonde à l’intégrité physique et psychologique d’une personne ou d’un groupe. L’usage d’armes létales ? Les affinités néo-nazies ? La constante remise en doute de la légitimité et du droit des personnes racisées à être librement chez elles en France ? Les insultes homophobes des policiers en manif ? Les passages à tabac répétés, les yeux et les mains des manifestant•es explosés ? Tout cela rentre dans le cadre conceptuel de la violence, les faits interpersonnels étant de surcroît supportés et légitimés par une institution structurellement violente et problématique.
Et la destruction d’une voiture ou d’une mairie vides ? Les feux d’artifices tirés à Montreuil ? L’énonciation explicite du fascisme de la police*** ? Les coups de pieds ou les pavés lancés en riposte à une police qui charge et qui tue ? Rien de cela n’est à proprement parler de la violence - il s’agit de dégradations matérielles ou symboliques, de pratiques disruptives, de discours politiques, de légitime défense°. Depuis le début de l’insurrection, la seule véritable violence dont j’ai entendu parler du côté des révolté•es consiste en cette fameuse voiture en feu chargée contre l’habitat d’un maire. Certes, cet acte est violent, et de ce fait, condamnable moralement et politiquement. Mais ni politicien•nes ni journalistes n’ont attendu ce fait pour utiliser le terme de violence. Il est dans toutes les bouches depuis la semaine dernière, convoqué pour tout ou rien, à tel point que, comme le lapin qui crie constamment au loup, on peine à y croire lorsque l’alerte correspond pour une fois réellement au fait.
Il aurait pourtant été tout à fait possible de questionner l’efficacité des moyens insurrectionnels sans les qualifier de ce qu’ils ne sont pas. Mais ce n’est pas un hasard si la nuance n’a pas été au rendez-vous des réponses et des représentations politiques et médiatiques entourant l’insurrection. Taxer la moindre expression de la colère, la moindre pratique subversive, le moindre dérangement de l’ordre, de « violence », sert d’une part à discréditer en bloc la réaction politique aux violences policières, et d’autre part à déplacer la focale sur la gravité présumée des révoltes populaires, suivant un habituel, étonnement habile, retournement de la culpabilité.
Ce que dit l’insurrection : raviver ensemble les colères silenciées
Que se passerait-il si nous prenions les faits pour ce qu’ils sont - l’expression des colères politiques ? La colère est une émotion qui survient en réponse à l’expérience ou à l’observation d’une injustice. En ce sens, elle est un baromètre sensible qui permet à chacun•e de juger de la légitimité de ce qu’iel vit ou voit. L’expression de la colère est sûrement proportionnelle à la représentation que soi-même et les autres en ont : dans un monde où les femmes en colère sont hystériques et les Arabes en colère sont sauvages, être en colère n’a pas la même signification sociale pour toustes et représente un danger pour certain•es. Alors la colère s’accumule, une pile de suie au fond de la gorge. Lorsqu’elle est exprimée en mots, en manifestations, en tribunes ou en associations, elle ne rencontre que du mépris. Lorsqu’elle se retourne contre le sujet qui la vit et ronge sa santé mentale, ou qu’elle ricoche sur plus petit•e que soi en violences intra-familiales ou intra-communautaires, elle est encore ignorée et reléguée au fameux « privé ».
Depuis dix jours, elle éclate au grand jour, celle de l’une déclenche celle de l’autre, dans le bouche à bouche circule enfin un souffle qui embrase tous les tas de cendres. Les faits insurrectionnels recèlent de réalités et d’expressions politiques : ils disent non seulement l’agentivité et la puissance des laissé•es-pour-compte, mais aussi l’accumulation de colères légitimes jusqu’alors assourdies ou minimisées.
La destruction est proportionnelle au désespoir
La nature destructive de l’expression actuelle de la colère vient alors précisément de tant d’années et d’existences passées à s’essouffler, pour crier des rages reçues par de l’indifférence, du mépris, et de la violence. La philosophe Laura Silva**** déconstruit dans un article l’assimilation habituelle de la colère à la violence: elle démontre que l’usage de moyens destructifs est proportionnel au désespoir des sujets en colère. Autrement dit, moins l’on a d’espoir que la situation change, et plus on emploiera des moyens radicaux pour exprimer sa colère. Or, chaque nouvelle victime du racisme et de la police troue un vide dans la conviction intime que les choses peuvent encore changer. Le désespoir est politique - si les gens détruisent, c’est parce que certaines violences sont irréversibles et que face à leur récurrence, il est difficile d’espérer encore sans se soulever.
Il n’y a pas un moyen plus efficace qu’un autre d’exprimer une colère politique
Face à ce qui devrait être salué comme un soulèvement courageux, et amplifié par des mobilisations alliées et ailleurs, certain•es s’insurgent à gauche de l’inefficacité des destructions matérielles. Mais les moyens d’expression politique bourgeois sont-ils vraiment plus efficaces ? Signer des pétitions, manifester de temps en temps, faire circuler des tribunes, voter, laquelle de ces pratiques a-t-elle réellement changé la donne depuis quelques années ? Nos mouvements sociaux sont dissous, nos marches les plus pacifiques sont réprimées, nos valeurs sont criminalisées et nos représentant•es politiques sont méprisé•es par des passages en force. Je ne dis pas que ces moyens sont dérisoires - je pense qu’il faut multiplier nos expressions politiques et être creatifves et disruptifves face à l’interdiction grandissante de ne pas être d’accord avec l’arbitraire d’Etat. Face aux multiples injustices sociales et violences systémiques, nos colères peuvent être converties en compréhension politique des vécus individuels; en action subversive et en expression enragée; en communautés résistantes et révoltées. Il n’y a pas un moyen plus efficace qu’un autre pour exprimer sa colère, performer sa puissance politique, se rendre visible, créer des alliances, dans un pays où la moindre expression de désaccord est matée et criminalisée.
Dire que les destructions encouragent et légitiment les discours haineux, ou provoquent une riposte policière plus violente encore, c’est supposer que les idéologies et les pratiques fascistes seraient moindres si on laissait sagement passer leurs « bavures ». Il s’agit d’une profonde erreur de raisonnement : la police tout comme l’extrême droite ne font que prendre nos insurrections pour prétexte de leur violence. Mais la réalité est que ni l’un ni l’autre n’ont attendu que des voitures ne brûlent pour être racistes. Leur violence n’est fondée sur rien d’autre qu’une idéologie, sécuritaire et haineuse, qui se nourrit d’elle-même et de n’importe quelle forme de résistante politique. Dès lors, la récupération politique ne devrait pas nous empêcher de lutter, au contraire : là où toutes les oppositions sont taxées de « violence », nous devrions multiplier les transgressions.
Alors, au lieu de rester dans son coin à prétendre soutenir le fond tout en critiquant la forme, le peuple de gauche devrait faire l’effort d’identifier la violence dans les systèmes de pouvoir et de pensée où elle se loge, soutenir l’insurrection et dénoncer sa cause première, au lieu de tomber dans le piège de la diabolisation de toute dissidence.
° Au sujet des destructions de petits commerces, de mobiliers urbains, des voitures de particulier•es, le discours ambiant est une fois encore à la dénonciation : les insurgé•es nuiraient à leurs semblables et se tireraient des balles dans les pieds en portant atteinte à leurs infrastructures. À cela, deux réponses : d’une part, c’est évidemment l’Etat qui devrait prendre ses responsabilités, payer pour ces dégâts, indemniser les personnes qui en auraient souffert, bref réparer les dommages matériels que génèrent indirectement les violences policières. D’autre part, l’empressement avec lequel on s’affole pour les infrastructures de banlieue exprime peut-être l’intuition généralisée que ces destructions ne seront pas réparées, que ces pertes économiques ne seront pas compensées, bref qu’une fois encore ces territoires seront abandonnés à leur sort alors même que ce sort a été jeté par l’Etat.
* Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme interpelle ainsi la France au sujet des « profonds problèmes de racisme parmi les forces de l’ordre »
** Il est intéressant de noter que pour Aristote, la cause première ne dépend d'aucune autre cause et ne tient que d'elle-même son principe et son efficacité - elle est en ce sens une cause libre, là où les causes secondaires (parmi lesquelles notre fameuse cause de proximité) sont déterminées par la cause première.
*** d’après une enquête Cevipof de 2021, 60% des policier•es avaient l’intention de voter pour le RN aux élections présidentielles de 2022.
**** Laura Silva, « The efficacy of anger: recognition and retribution ».
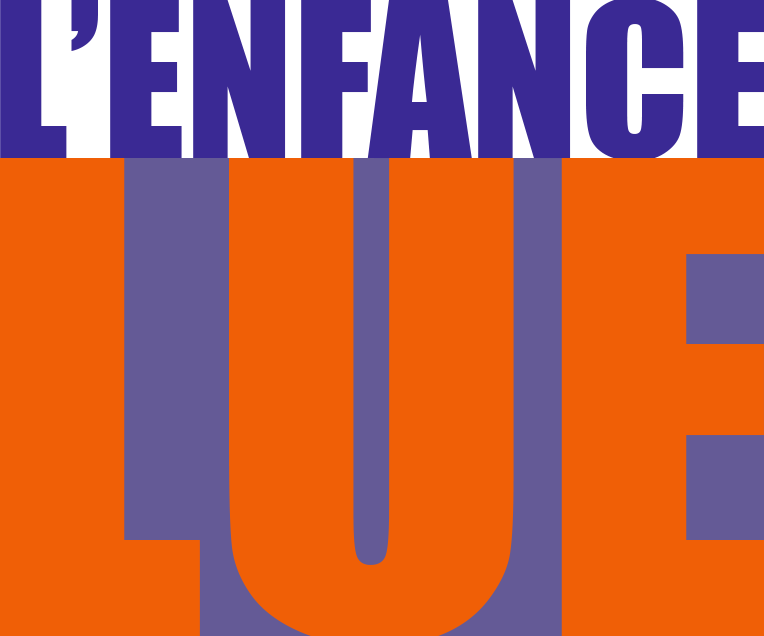
Commentaires