La peur, un instrument politique d'assignation à nos places
- Ella
- 23 mai 2023
- 7 min de lecture
Elle se transmet dans les histoires, elle colore nos imaginaires de tâches sombres. On l’entend dans les mots des autres, on l’hérite jusque sous nos peaux. Elle transpire d’en dessous des chiffres, dans les colonnes de faits divers et à mesure que l’on apprend. On la lit dans les yeux qu’on aime. Elle tambourine dans le ventre parfois. Elle triomphe dans tout ce qu’on ne fait pas. J’aimerais qu’on parle de la peur.
De la peur de la violence : celle qui vient de notre intuition et de notre expérience intime d’être exposé•e et vulnérable aux mots, aux coups, aux violations d’autrui. Cette peur là, en réalité, ne concerne pas seulement la potentialité de la violence de l’autre. Elle est aussi fondée et logée, de manière primordiale, dans ce que nos propres corps expriment et renvoient malgré nous. Nous craignons que notre existence charnelle et sociale trahisse une identité que d’autres s’autorisent et s’emploient à malmener. Mon frère aurait moins peur que moi de rentrer seul chez lui le soir - mon corps de femme dans les yeux des hommes m’expose à un danger qu’il ne connaît pas. J’aurais moins peur que mon voisin en croisant une voiture de flics - sa peau noire dans les yeux de la police l’expose à un danger que je ne connais pas. Certes, notre peur vient de l’existence d’un autrui qui pourrait nous faire mal. Mais cette seule explication réduit la peur à être la conséquence d’une humanité naturellement et également malveillante. Or, celleux dont la couleur, le genre, l’accent, les orientations, sont dominants, ont moins peur que les autres. Nos peurs viennent de ce à quoi nos corps nous exposent dans une société dont la violence est proportionnelle à ces facteurs arbitraires que nous n’avons pas choisis, mais qui nous définissent aux yeux des autres.
À certains, on n’enseigne pas la peur - seulement la prudence, peut-être, de temps en temps. À la majorité, on apprend à avoir peur, pour se protéger, pour éviter le pire, pour survivre. La philosophe féministe et anti-raciste bell hooks, lorsqu’elle raconte son enfance dans le Sud ségrégationniste des États Unis, explique qu’on lui enseignait de taire sa colère, parce que l’exprimer représentait un danger de mort: on peut mourir d’être en rage lorsqu’on est noire. À beaucoup, donc, la peur est inculquée comme le moyen le plus efficace de se protéger de la violence: plus on redoute cette dernière, et plus on parvient à l’éviter. La peur avance main dans la main avec les moyens concrets de, croit-on, éloigner le risque : on encourage les filles à se couvrir lorsqu’elles sortent quelque part ; et puis à certaines autres filles, on suggère de se découvrir la tête lorsqu’elles rentrent quelque part. On conseille aux personnes queer d’éviter certains pays ; on enseigne aux enfants noirs à taire les émotions qui pourraient leur nuire. On inculque la peur d’être seul•e, la peur de l’aventure, la peur de l’expression libre - émotionnelle, amoureuse, vestimentaire, politique - de soi.
De fait, nous avons des milliers de raisons d’avoir peur. Certaines vies sont plus vulnérables que d’autres ; les récits, les expériences, ce que montre l’actualité et ce que raconte l’histoire, regorgent de violences qui laissent certainEs bouleverséEs, et apeuréEs, à l’idée d’exister dans un monde où être soi est un risque. Au regard des menaces structurelles qui planent sur certainEs, qui s’empilent sur les épaules d’autres, la peur est appropriée. Elle est justifiée. Elle est légitime.
Il me semble pour autant que la peur sert et renforce les structures de domination sans réellement nous en protéger d’une part, et en renonçant à s’y opposer de l’autre. D’abord, celleux dont l’identité est opprimée feront - un jour ou l’autre, avec plus ou moins d’intensité et de fréquence, mais néanmoins nécessairement - l’expérience de la violence. Précisément parce que les violences font système, nous sommes constamment exposé•es à leur occurrence - que l’on soit dans l’espace intime ou social, professionnel ou familial, dans sa rue ou au bout du monde, nous ne sommes nulle part à l’abris. Que l’on soit couverte de la tête aux pieds ou complètement nue, que l’on ne sorte pas de sa ville ou qu’on voyage seule en stop, aucune de nos peurs ne sont assez puissantes pour repousser la violence. Cela ne veut pas dire que nous souffrirons toujours, que certaines existences ne trouveront jamais de repos ni de foyer - évidemment, les relations, les communautés, les vies, alternatives fleurissent et les îlots de respect, d’affection et d’entraide existent et ont toujours existé. Les vulnérabilités mises en commun alimentent les forces et les joies nouvelles, et opposent à la violence et au pouvoir d’autres possibles politiques et affectifs.
Mais ces solutions là ne viennent pas de la peur. Elles la reconnaissent, l’accueillent, certes, mais surtout la désamorcent. Ces résistances là contredisent l’injonction à la peur qui voue les existences au silence et à l’apathie. Il s’agit alors de dépasser la peur et de combattre ce qui la fonde, plutôt que de s’y noyer.
Pourquoi, d’autre part, la peur est-elle un refus de s’opposer ? Je crois que la peur est l’inverse de la résistance. Elle nous inhibe, réduisant nos libertés de mouvement, d’expression, d’aventures, d’initiatives, à l’état de potentialité dormantes qu’on craint d’actualiser. Une fois encore, c’est légitime d’avoir peur lorsque notre position sociale nous expose de fait à la violence des autres. C’est légitime d’avoir peur de rentrer seule le soir quand on est une femme, d’avoir peur d’aller au Texas ou en manif en France quand on est noir•e ou arabe, d’avoir peur d’aller chez le gynéco ou à la piscine avec les autres quand on est trans. Je tire ces exemples d’expériences, de récits, de films ; la plupart des peurs me sont étrangères, je ne les vivrai jamais dans mon corps, je ne les imagine même pas. Elles habitent d’autres vies que la mienne, ponctuent d’autres quotidiens, déterminent et limitent des choix que j’ai le privilège de faire sans me poser la moindre question.
C’est précisément en ce sens que la peur renforce ce qui la fonde au lieu de s’y opposer : elle maintient chacun•e d’entre nous à sa place. En laissant la peur nous guider, nous composons avec les règles injustes qui orchestrent inégalement nos vies. À partir de l’intuition, de l’expérience ou de la connaissance de la réalité de la violence, nous orientons nos choix et laissons de ce fait triompher les dominations qui visent précisément à limiter nos existences.
En tant qu’émotion influençant et inhibant l’action, la peur nous astreint à la situation et à l’expression que le monde nous octroie. Elle nous empêche de s’en extraire en nous paralysant. À chaque fois que par peur, nous refusons de faire ce que nous aurions souhaité, nous allons dans le sens des limitations injustes et contingentes qui constituent la domination. Vivre dans la peur nous réduit à s’accommoder de nos situations - à agir au sein du cagibi minuscule, restreint et contraignant dans lequel nous avons été enferméEs, tandis que d’autres jouissent d’un salon entier de possibilités, que d’autres encore ont un palace d’options et d’horizons possibles à embrasser sans prendre aucun risque. Nous demeurons fondamentalement frustréEs de ne pas avoir transcendé cette situation, de ne pas avoir forcé la porte du cagibi pour oser profiter du couloir dans lequel courent déjà tous les autres.
Cette métaphore a ses limites : sortir du cagibi demande une fenêtre pour voir que d’autres ont déjà réussi ; cela exige aussi que d’autres personnes nous aident à déboulonner la porte. La simple possibilité de concevoir que d’autres choix existent et que nous sommes légitimes et capables d’en profiter nécessite des ressources parfois économiques, politiques, de l’imagination. Cela nécessite d’être encore en contact avec ses propres désirs, de croire encore à la possibilité de sa propre liberté. Peut-être que certaines vies sont définitivement dominées par la peur, dont l’intensité est devenue inébranlable. Ce qui est certain, c’est que la capacité à surmonter ses peurs dépend d’un ensemble de facteurs face auxquels, une fois encore, nous ne sommes pas à égalité.
De plus, une fois franchi le seuil de la porte, le couloir infini de libertés et d’aventures n’est pas le même pour tout le monde. Il y a d’autant plus d’embûches et d’autant moins de lumières pour celles et ceux qu’on a essayé de terrasser par la peur avec le plus d’acharnement et depuis le plus longtemps. Il est d’autant plus difficile et risqué de dépasser la peur pour celles et ceux qu’on ne veut surtout pas voir ailleurs que dans le trou minuscule que l’histoire et la politique ont creusé pour elleux.
Ce qui me semble fondamental, c’est que la peur est un instrument politique de domination. Subrepticement, en se faisant passer pour des conseils, des contre-exemples, des velléités de protection, la politique de la peur nous assène chaque jour ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. Certaines peurs sont peut-être universelles et moins sociales que les autres - être au bord d’un précipice ou face à une silhouette qui brandit un poignard. Mais ces peurs là émergent lorsque l’on est effectivement exposéE au risque. La majorité des peurs qui nous habitent sont le produit d’une histoire et d’une éducation qui prennent les devants sur l’expérience et qui présentent la violence comme un acquis, une fatalité à partir de laquelle nous devons construire nos vies. Il y a un arbitraire évident dans l’éducation à la peur, qui trahit sa dimension politique : comme le montre La journaliste féministe Valérie Rey-Robert, par exemple, on nous enseigne à craindre les parkings mal éclairés alors que 91% des viols et tentatives de viols sont commis par des proches de la victime. Certaines choses font démesurément l’objet d’une politique de la peur qui sert une représentation stéréotypée et souvent xénophobe du danger ; d’autres choses ne nous sont pas enseignées comme dangereuses alors qu’elles le sont tellement plus. À l’école, dans les pubs et dans les films, ainsi, on ne nous apprend pas assez à craindre la police.
Je ne dis pas que la peur n’est pas parfois utile, voire nécessaire - je pense qu’il faut avoir conscience des dangers, de la violence, dans toutes ses formes. Je crois qu’il est important enseigner la prudence ; et d’apprendre à reconnaître, écouter et respecter nos peurs. Mais je crois aussi que l’on devrait forcer à chaque instant la porte du cagibi (pardonnez-moi son retour) qui restreint immensément nos choix et nos possibilités, et dont la peur est sentinelle. Face à la réalité de la violence et du risque, on devrait nous enseigner l’indignation, la colère et la subversion. Cela ne revient pas à faire l’éloge du danger ou de l’insouciance - mais à refuser que certains désirs et certains choix ne soient « pas pour nous ». Cela signifie encourager celles et ceux dont la liberté est un risque, à suivre leurs aspirations même si elles se mêlent à la peur, à faire ce qu’iels auraient fait si iels avaient eu le privilège de l’insouciance. Avec prudence, avec conscience, avec peur, sûrement. Mais à faire quand même - au lieu de laisser la peur amputer nos existences et triompher de nos rêves.
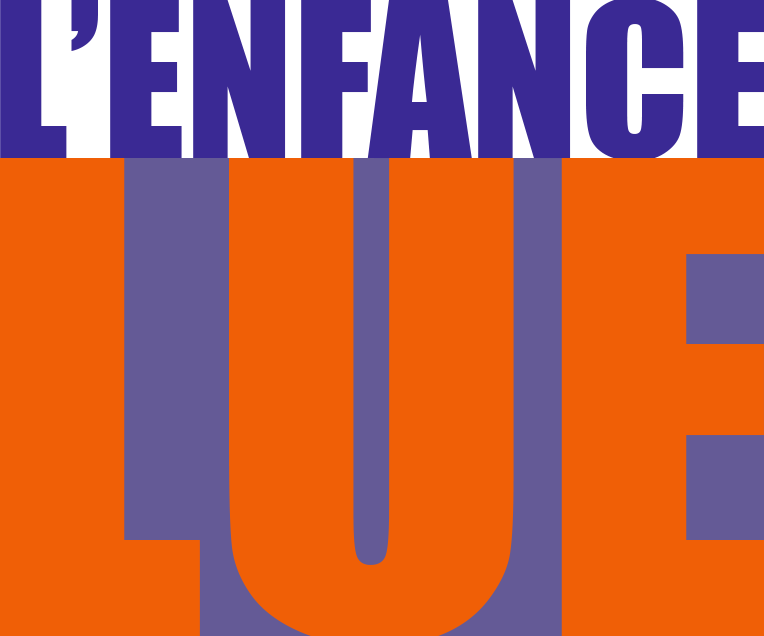
Commentaires