Lettre ouverte : où sont passées les cartes postales
- Ella
- 19 févr. 2020
- 8 min de lecture

À l’aube de la 5G qui promet de révolutionner encore, si c’est possible, les interconnexions et la communication longue-distance, l’avenir des correspondances papier est plus que jamais questionné. Pour élever leur voix au-dessus des grésillements d’Internet, un comité de factrices et de facteurs venant de partout en France s’est constitué en 2017. Ils signent, pour cette nouvelle année, une tribune collective un peu spéciale pour repousser la « mort des lettres ».
« J’ai voulu distribuer le courrier pour la première fois à sept ans, aux alentours de dix-huit heures, en sortant de l’hommage à Jacques Tati organisé dans mon village. Il avaient projeté Jour de fête. »
Diane, vingt-huit ans, Ste.-Sévère-sur-Indre.
« Au bout de quarante ans à tenir la boulangerie familiale, je l’ai refilée à mon frère et j’ai entamé une formation de postier. J’en ai eu assez de laisser mon métier de rêve exister chaque jour sans moi. »
Amir, soixante-et-un ans, Paris.
« C’est venu au collège. En troisième, il fallait faire un stage ; comme je ne trouvais rien, mon prof d’histoire m’a conseillé la Poste, en m’assurant que de grandes choses s’étaient faites couchées sur du papier et scellées dans l’enveloppe. Je n’étais pas convaincu ; mais au bout de cette semaine j’avais finalement trouvé ce qu’ils appelaient sans cesse ma 'perceptive d’avenir' »
Adrien, vingt-deux ans, Marseille.
« Je n’ai pas choisi ce métier. Arrivée en France depuis deux ans à peine, ma marraine à l’association m’a dit de prendre le poste, que c’était un bon début. Là-bas tout le monde a été gentil avec moi, c’était un travail fatigant mais je marchais dans la ville, alors je suis restée. »
Fatima, trente-huit ans, Lyon.
« Ma première expérience de factrice, c’était dans la cour de récré, Le facteur n’est pas passé. Quand des années après je me suis retrouvée là, cette mélodie résonnait souvent dans le bureau de Poste, à l’heure où il se vide et où l’on s’apprête à fermer. C’est un beau métier, dont je suis fière. »
Cécile, quarante ans, Orléans.
« Moi c’est petit, en voyant toujours Madame Valette en bas de l’immeuble, avec son vélo et sa casquette jaune. J’aimais bien sa dégaine, et pendant une scolarité galère en fac' de psycho je l’ai recroisée et je me suis dit, "pourquoi pas ?". »
Diego, trente ans, Paris.
« C’était le métier de mon père, de sa mère avant lui. Au village vous savez, on naît avec une carrière toute tracée. Y’a ceux qui seront maires, ceux qui seront bûcherons, et y’a le facteur. C’était moi. Cinquante ans que je fais ce métier. »
Daniel, soixante-cinq ans, Baives.
Chères lectrices, chers lecteurs. Voilà pour commencer les mots de certains d’entre nous à propos de leur métier. Ils disent déjà, croyons-nous, la diversité et l’intensité du travail qui nous a regroupé.e.s, il y a maintenant trois ans.
Nous sommes femmes ou hommes, jeunes ou âgé.e.s, né.e.s en France ou autre part, plus ou moins passionné.e.s. Nous avons en commun, vous l’avez compris, notre métier, et le soucis de le préserver. C’est ce dernier qui nous a poussé à prendre la plume.
Après avoir longuement échangé sur le net - ironie du sort, n’est-ce pas - nous avons décidé de nous faire « Comité », et nous nous sommes mis à correspondre les uns avec les autres. Pour stimuler l’acte d’écriture et pour ne pas perdre ce souffle nouveau qui nous faisait du bien à tous, nous avons instauré des jeux, des sortes d’exercices de style, très libres et divers. Il y a quelques semaines, nous nous sommes réunis, comme occasionnellement dans l’année, et nous avons mis en commun le récit de nos sensations face à la menace montante de ce que nous avons appelé, la mort des lettres. Ce travail a produit des textes qui nous ont grandement émus, et qui ont, autant que nous pouvons en juger, beaucoup en commun. Aussi avons-nous éprouvé le besoin de transmettre à ceux qui voulaient bien l’entendre notre sentiment ; deux d’entre nous se sont proposés de dévoiler leurs textes, et nous les avons retravaillés ensemble. Nous avons cherché à dire le plus justement ce que signifie être facteur ou factrice, et ce que nous ressentons comme une angoisse croissante en ce moment. Cette lettre est écrite pour sauver l’avenir de toutes les autres.
« Je travaille encore, certes. Mon métier n’a pas été rayé de la liste comme l’est celui des caissières ou des standardistes. On n’en parle même pas, nulle part, on nous laisse tranquille, alors, pourriez-vous penser, pourquoi s’agiter ? Ma réponse, c’est, Cela fait longtemps que l’on n’existe plus.
J’ai choisi ce métier pour distribuer des lettres. Je l’exerce depuis que j’ai le bac. Au début, ça a été difficile : au bureau les autres connaissaient déjà bien le quartier, moi je venais de Villejuif et Place des Fêtes, ça ne me disait rien. Les trois premiers jours j’ai suivi Robert, il était plus âgé et expérimenté, et je ne faisais que distribuer l’autre moitié de son paquet. Très vite on m’a laissée seule, et les premières semaines je me suis perdue entre les maisons, dans les impasses alambiquées. Je ne retenais ni les rues, ni les immeubles ; au bout de deux mois je connaissais tous les noms. À l’époque, le tas de courrier était assez conséquent. En période de vacances scolaires, je me souviens avoir ployé sous le poids de mes sacoches. Il s’agissait surtout de cartes postales envoyées à des copains ou aux mères restées travailler, parfois de correspondances renouvelées après l’interruption des semaines surchargées, de temps en temps, quelques colis pour Noël, ou du sable posté d’Egypte dans une bouteille en plastique. Je me souviens de l’orthographe de ce petit garçon écrivant de colonie de vacance à sa sœur hospitalisée à Robert Debré ; et de la calligraphie italique d’une vieille femme à son amant d’antan. Ce que j’aimais le plus, c’était de toucher le papier et d’y sentir les marques du stylo, des larmes, des ratures. Je repérais les stratégies pour corriger une faute, en la transformant en dessin de fleur au beau milieu d’un mot ; et les mille expressions qui existent pour dire adieu, d’« à bientôt » à « crois-moi. »
Je l’avoue sans peine car c’est quelque chose auquel on doit s’attendre ; je lisais les lettres. Les cartes postales aussi, d’un coup d’œil distrait ; mais les plus exaltantes étaient vraiment les lettres. J’y ai lu des couples se déchirer, des amitiés s’aiguiser, des espoirs s’effondrer. J’ai parfois pleuré en glissant les faire-parts, j’ai parfois rêvé d’abolir la distance pour réunir des amoureux et j’ai longuement attendu des réponses qui ne sont jamais venues.
Aujourd’hui j’oublie les noms ; ils ne reçoivent plus de lettres. Il y a bien des colis, d’énormes cartons à déposer chez les gens qui ne sont jamais là, et les cartons retournent dans les casiers de la Poste, et la seule chose que je glisse encore à travers les fentes sont les avis de passages griffonnés avec impatience. Sur les emballages Amazon, les noms sont imprimés sur des étiquettes blanches, en-dessous du code barre et à côté d’une série de chiffres. Je ne vois rien derrière ces lettres-là, sont-elles en majuscules, sont-elles celles qui constituaient les noms que je pouvais chanter de mémoire il y a une poignée d’années. Les lettres capitales, en caractère gras, ne veulent rien dire, ni type de papier ni couleur de prédilection du stylo, ni dernière nouvelle ni petit cœur en bas de page, ni tournures de phrases habituelles ni signature. À mesure que ces noms deviennent des successions de grandes lettres noires moi j’oublie qui étaient ces noms.
Tout les jours le poids m’accable - bonbons américains, nouvelle télévision, livres scolaires - et je reviens le soir au bureau avec le même poids sur le dos, parce que tout le monde est absent pour réceptionner son colis. Je me demande presque à quoi tout cela rime ; heureusement il y a parfois quelques cartes postales du sud de l’Espagne ou des photos imprimées sur du papier glacé, et timidement signées au dos. Où sont passées les longues lettres ? Mes voisins préfèrent-ils désormais l’électroménager aux grandes phrases poétiques, les emballages plastique aux vieilles enveloppes craft ?
J’habite là, depuis quelque temps, à côté de ceux que je livre. Moi non plus, je ne reçois rien. Préfère-t-on désormais les objets aux mots ? »
« Moi, je suis plus âgé qu’elle. Je croyais partir à la retraite bientôt mais la réforme en décide autrement, alors je reste encore quelques années. Je me suis toujours déplacé à vélo ; aujourd’hui je ne peux plus, ma cheville est trop fragile alors on m’a relégué aux bureaux, d’un ennui extraordinaire. En pensant aux successions de jours qui m’attendent, debout derrière le guichet, je suis déjà fatigué. Mais là n’est pas le sujet : l’exaltant dont je voudrais vous parler est derrière moi, parcourant mon village du Berry à bicyclette et sillonnant la vallée pour rejoindre le bourgs.
Moi, je n’ai jamais lu ni lettres, ni cartes postales, ni quoi que ce soit d’autre que les noms. Les noms disaient déjà beaucoup : l’écriture peut être tremblotante ; c’est souvent au stylo bille et d’autres fois à l’encre celle qui fait de larges tâches brunes lorsqu’on ne sait pas manier la plume ; le nom est tantôt avant le prénom, tantôt après et tantôt oublié ; l’adresse est parfois lacunaire ; il arrive qu’un tas de dessins ou d’écritures débordent et rendent la lecture difficile… Les quatre lignes destinées au facteur en disent plus long, à mon sens, que les dizaines de pages de courrier qu’elles adressent.
Depuis quelques années les choses se sont essoufflées.
Comme l’a dit ma consœur, les noms changent de forme. On assiste à la mort du manuscrit. Car c’est là tout le problème, laissez-moi vous le dire. Les gens s’envoient encore des mots, seulement il ne s’agit ni d’envois, ni de mots. Ils appuient sur une touche ou sur un coin de leur écran pour lâcher dans l’espace infini et invisible du numérique les messages qu’ils veulent transmettre. Aujourd’hui on peut parler à l’autre bout du monde en quelques secondes. Plus besoin de papier, de crayon, d’endroit lisse et stable où dérouler le parchemin, plus besoin de s’attabler, de se faire mal au poignet. Plus besoin de chercher ses mots, et les gens communiquent sans réfléchir - d’ailleurs je suis d’avis qu’on pourrait souvent se passer des phrases reçues ou envoyées. Il y a même des petits bonshommes qui ôtent les mots des doigts. Plus d’heures passées à tenter d’exprimer l’intensité de ce que l’on ressent, plus de quête des termes justes, quand les lettres sont inépuisables sur le clavier et que des dessins font sens à la place des mots. Voilà où sont passées les cartes postales : évaporées entre deux bulles de messages instantanés. Les plus grandes déclarations se font au téléphone, se pianotent à la pause déjeuner. Les nouvelles ne voyagent plus, les changements ne prennent plus l’avion, le bus, le vélo. Nous ne portons plus dans nos sacoches le poids de l’avenir. L’avenir s’envoie de lui-même d’un bout à l’autre de la planète ; figé sur un fil d’actualité ou dans un email, il disparaît lorsque l’on ferme l’onglet.
Ma grand-mère me racontait parfois les pluies de lettres au lendemain de la guerre : je me souviens de ses larmes à l’évocation de celles des voisins qu’elle livrait, qui applaudissaient sa tournée, qui l’attendaient sur le pas de leur porte. À l’époque les émotions passaient encore de main en main, d’homme à homme.
Pour ma part il y a longtemps que je n’ai plus vu de tas de lettres ; même les journaux ligotés par des cordes fines ont disparu ; même l’annonce des mariés, des nouveaux-nés, ne passe plus par le courrier.
À moi seul au village sont encore adressées des enveloppes épaisses au timbre soigneusement léché, collé un peu de travers. Ce sont celles des membres du Comité, et cela fait sourire mes collègues, ils se battent pour la tournée lorsqu’ils voient mon nom couché sur le papier. Je garde tout ce que je reçois : lettres, cartes postales, photographies, et surtout les enveloppes, carrées, longues, préaffranchies, cartonnées, craft, bulles. Je suis comme un collectionneur qui essaie de récupérer les miettes du passé dont il entretient l’ombre du souvenir. Les messages, on ne les garde pas, on ne les possède même pas vraiment. Ils passent juste sous nos yeux, filtrés à travers des rayons bleus ils délivrent leur sens le plus superficiel et disparaissent aussitôt. On apprend la joie, la peine, la mort, la guerre, aussi indifféremment que l’on lit l’heure ou que l’on paie nos factures. Les sentiments, en perdant leur encre, ont perdu leur forme.
Il était précieux, le temps où nous relions les mains éloignées.
Nous étions les passeurs d’amour. Nous relayions les questions brûlantes. Nous ouvrions la porte au deuil ; grâce à nous se propageait un rire. »
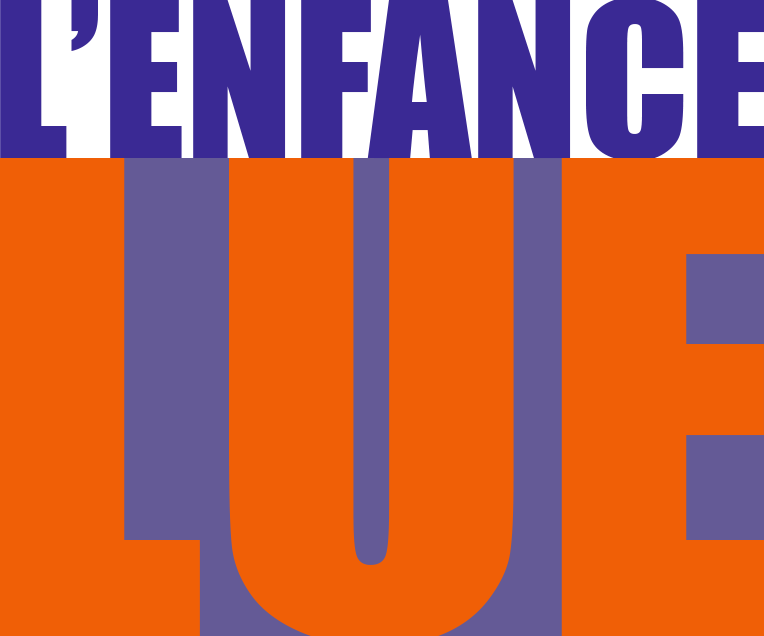
Commentaires