Sa majesté Woody
- Jude
- 18 mai 2016
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 16 juil. 2023

Woody Allen, roi de l'amour.
On ne parle ici bien évidemment pas de la vie privée amoureuse et sexuelle du cinéaste américain, pour le moins ambigüe, sujet sur lequel la presse mondiale, en admiration devant son oeuvre, ne le questionne jamais, comme l'a dénoncé son fils Ronan Farrow il y a quelques jours dans le Hollywood Reporter, sujet sur lequel l'a courageusement et malicieusement (quoique puisse en dire la presse française...) taquiné l'acteur français Laurent Lafitte lors de la cérémonie d'ouverture du 69ème Festival de Cannes, mercredi dernier.
En revanche, lorsqu'il s'agit de septième art, le réalisateur de Manhattan n'est jamais aussi bon que lorsqu'il parle d'amour et l'amour est très très rarement aussi bien filmé et décliné sous de nombreuses formes que par sa patte.
Le New-Yorkais en a une nouvelle fois fait l'éblouissante démonstration avec son nouveau film, Café Society, qui a ouvert le rendez-vous cannois et envahi les écrans français il y a une semaine tout pile.
Décrié ces dernières années pour des films -que je n'ai pour la plupart pas vus- jugés peu inspirés voire carrément mauvais, le grand Woody signe un retour magistral et livre ce qui ressemble à un film testament (même si on ne doute pas qu'il en réalisera encore bien d'autres et mourra probablement une caméra à la main) tant il semble résumer son cinéma, son génie.
Café Society parle d'amour et est en ce sens le digne descendant des plus grands films du père de Radio Days, auquel on pense d'ailleurs beaucoup devant le film.
L'amour n'est plus le couple fantasque, loufoque et intelligent de Annie Hall, ni l'adultère passionnel, physique, séduisant, monstrueux de Match Point.
L'amour est maintenant la rencontre de deux jeunes gens purs, insouciants, virevoltants, qui découvrent le monde dans le tourbillonnement de la haute société de Hollywood. L'amour tombe de haut, s'achève dans un souffle amer et frustrant. L'amour se déplace, se transforme, s'oublie. Et l'amour renaît, lorsque "le passé refait son irruption par une porte" comme le conte la voix off, aussi légère et agréable qu'elle était lourde et insupportable dans Vicky Cristina Barcelona.
L'amour s'appelait Woody Allen et Diane Keaton, Scarlett Johansson et Jonathan Rhys Meyer.
Il s'appelle maintenant Kristen Stewart et Jesse Eisenberg. Et c'est (au moins) aussi beau, aussi bien.
On a jamais vu aussi fabuleux clone du cinéaste que le super Eisenberg, qui apporte en plus au personnage sa capacité, déjà vue dans le très bon Social Network de Fincher, à dissimuler un être assez sombre et machiavélique derrière un visage d'ange innocent.
Et quelle carrière que celle qu'est en train de bâtir Kristen Stewart! On croyait l'héroïne de la saga Twilight condamnée à rester, comme tant d'autres avant elle, une icône pour adolescents, et à disparaître progressivement des radars.
On se fourvoyait, mais alors dans les grandes largeurs! On l'a depuis vue tour à tour dans Sils Maria d'Olivier Assayas, Still Alice de Richard Glatzer et Wash Westmoreland et, donc, dans Café Society (elle est également à l'affiche du nouveau film d'Assayas, Personal Shoper, en compétition à Cannes), toujours aussi surprenante et réjouissante dans ses choix que parfaite dans ses prestations.
Le duo concocté par Allen est d'autant plus génial qu'il rassemble deux acteurs incroyables dans leur jeu, totalement à contre pied de l'éternelle mode hollywoodienne de la performance: ils semblent toujours jouer de la même manière ou presque (mêmes mimiques...) mais confèrent toujours à leurs personnages, qu'ils comprennent parfaitement, quelque chose de toujours différent et merveilleux.
Woody Allen déploie autour du fil rouge amoureux une panoplie de personnages fantasques, originaux, qu'il prend un malin plaisir à décrire. Son histoire est ainsi parsemée d'anecdotes, d'incises, qui lui permettent d'adoucir son propos sans jamais perdre le fil et en enrichissant toujours son oeuvre, ponctuée de dialogues magistraux, notamment sur la religion et l'humanité, qui prennent tout leur sens quand on sait que l'histoire se déroule à la fin des années 30, soit juste avant que la première propulse la seconde jusqu'au bout de l'enfer.
Le tout est parfaitement construit par une équipe technique rodée depuis des décennies: derrière la caméra, Woody déroule son sujet et ses plans et filme toujours aussi bien New York, le génie Vittorio Storaro offre une photographie splendide et le montage est très bon (particulièrement le superbe raccord qui marque le passage du récit de Los Angeles à New York).
Le chef d'oeuvre, prend fin en 1939, à la veille de l'effondrement de la société humaine que le cinéaste raconte si merveilleusement, laissant la gorge serrée mais le sourire au lèvres au spectateur.
Jude
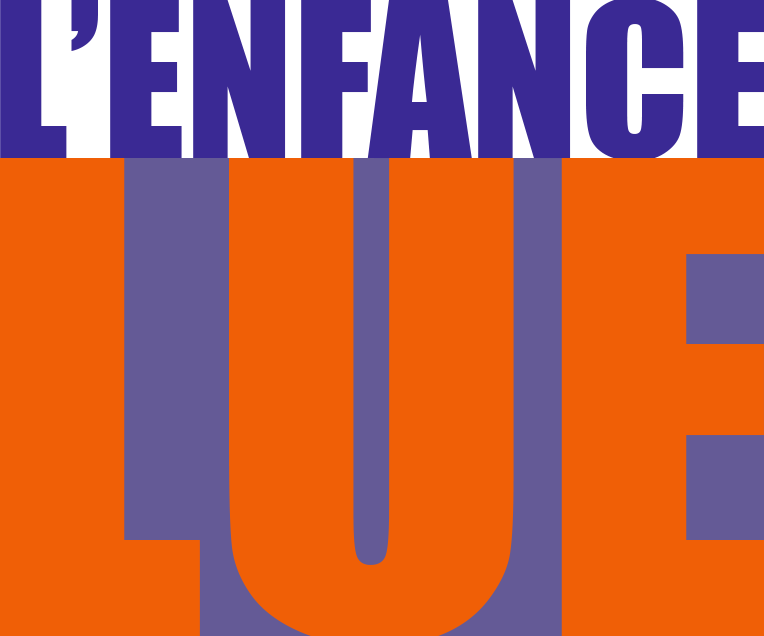
Commentaires